| Réalisateur : Wes Anderson |
| Acteurs : |
| Genre : Fantastique |
| Durée : 104 minutes |
| Pays : USA |
| Date de sortie : 21 juin 2023 |
Synopsis : Des événements révolutionnaires bouleversent de façon spectaculaire l’itinéraire d’une conférence de jeunes astronomes et de cadets de l’espace, dans une ville désertique des États-Unis vers 1955.
Nous y voilà enfin, le rendez-vous tant redouté, la rencontre qui intrigue tout autant qu’elle inquiète.
Wes Anderson, du côté de Kino Wombat, est une équation extrêmement fragile dont le dispositif obsessionnel de l’ordre et de l’agencement braque le regard, attise l’empire du vide jusqu’au dégoût. Une configuration qui ne parvient qu’exceptionnellement à toucher, toucher cependant jusqu’à la grâce. Une pensée traverse les esprits et rappelle la niche douillette où se dissimulent les merveilleux Moonrise Kingdom et Fantastic Mr Fox, faisant espérer vainement faire accéder à ce panthéon le nouveau Asteroid City..
Lors de l’épopée cannoise, il fut impossible d’accéder à la séance, les files « dernière minute » dégueulaient de spectateurs, poussant à attendre la sortie du film en France.
Ce qui intrigue toujours chez Anderson, c’est sa capacité à créer des espaces, des mondes à première vue diamétralement opposés, des cadres jamais vus, du camp de scouts au Paris des années 30, d’un grand hôtel à un sous-marin, d’une demeure familiale à une cabine dans un train.
Pour Asteroid City, le cinéaste continue à visiter un certain imaginaire américain, une recherche des bordures. Ici, le désert, les étendues, une configuration loin des intérieurs surchargés, des villes étriquées vient frapper l’univers fantasmagorique de Wes Anderson.
Un retour minimaliste, un retour à l’essentiel, serait-il alors possible ?

En visitant le désert comme miroir du cosmos, comme territoire parallèle, connectant l’humanité aux vies extraterrestres, Anderson approche le loufoque par la science fiction, construit une galerie de personnages déjantés et représentative d’un pays, confrontant les frénétiques protocoles états-uniens, son État sous quarantaine militaire et patriotique, à la réalité de l’humain, l’incommunicabilité des êtres.
Un engagement, une expression qui pourrait propulser la vision du cinéaste bien plus loin que ces abscons labyrinthes sans impasses, en voie unique.
Nous y suivons actrices, photographes, enfants sorcières, enfants scientifiques théoriciens, scientifiques blasés ou encore extra-terrestre.
Il mène tout ce beau petit monde à la rencontre du troisième type, vers la Zone 51, avec une véritable maîtrise, légèreté, comique touchant, que nous n’avions pas distingué depuis une bonne décennie. Les mystères se profilent et les songes de cheminements narratifs traversent l’esprit. L’union du fond et de la forme semble possible.
Cependant cette première heure réellement attirante ne parvient pas à prendre une nouvelle forme, le maniérisme nauséeux du réalisateur revient au galop, configurant ici un ersatz boiteux de Dogville, dans sa manière de déconstruire, laisser transparaître les coulisses, pour de nouveau communiquer avec sa communauté de retro kids en quête d’images doucereuses, de plans obsessifs, malades dans la quête de l’ordre, du contrôle.
Alors si il est vrai que certaines images ravissent la rétine, certaines couleurs nourrissent encore nos rêves, nous sommes ni plus, ni moins face à un trompe l’œil, où Anderson joue de références de cinéma, de textures, de façon plus habile que par le passé, certes, mais bâtissant du vide sur du vide, un parfait exemple de dégénérescence du dispositif.
Alors, il reste finalement à s’interroger sur le cinéaste, son parcours et son rapport à l’image, pour conclure qu’il s’agit bien plus d’un photographe, capturant une farandole de curieux acteurs, que d’un réalisateur de films parvenant à un certain art de la maïeutique.

Cela fait désormais bien plus d’une décennie qu’Anderson a perdu sa magie. Ses œuvres où il se concentrait sur un nombre restreint d’individus, pour nourrir le récit, le cadre et les interactions, se sont envolés, pour devenir, aujourd’hui, un hydre de stars hollywoodiennes se cannibalisant, ne laissant de marquant qu’une montée des marches bulldozer, et des films ennuyeux.
Dans le cas d’Asteroid City, seule Scarlett Johansson semble tirer le film à son avantage dans ce guêpier indigeste, ancrant même à jamais quelques postures dans nos mémoires.
Les autres acteurs font sourire le temps de les retrouver et sombrent dans le manichéisme impasse du cinéaste.
Notons d’ailleurs que Tom Hanks, intouchable encore il y a de cela quelques années, continue son atroce descente aux enfers et propose de nouveau une interprétation lourde, irritante.
Alors certes si l’on voit où veut en venir Asteroid City avec sa lecture parallèle d’une errance de la production hollywoodienne, post-Covid, sans vision, sans direction, regardant les étoiles pour espérer voir un événement hors du commun, que Wes Anderson essaie d’ancrer en profondeur à travers des strates narratives expérimentales entre pseudo-philosophie et constat autour de la théâtralité, de l’artificialité, le cinéaste se perd totalement n’empruntant au final aucune voie, ne faisant que les caresser, qu’il s’agisse du champ expérimental ou de la création d’un récit.
Un immense brouillon s’articule, une bête sans tête, enchaînant cadres hypnotiques complètement creux, dialogues poussifs et abscons et farandole de stars qui ne sont là que pour le clin d’oeil. Nous y avons cru le temps d’une courte heure pour sombrer encore dans une désillusion profondément écœurante.
Prenez vos Playmobil, créez une ville tout en parallélismes et névroses, lignes strictes, puis observez les habitants et leurs néants mutuels, vous en apprendrez ainsi plus sur le cinéma, l’humain et le monde.
De plus, votre imaginaire saura vous conter des récits bien plus complexes et excitants que le naufrage Asteroid City.
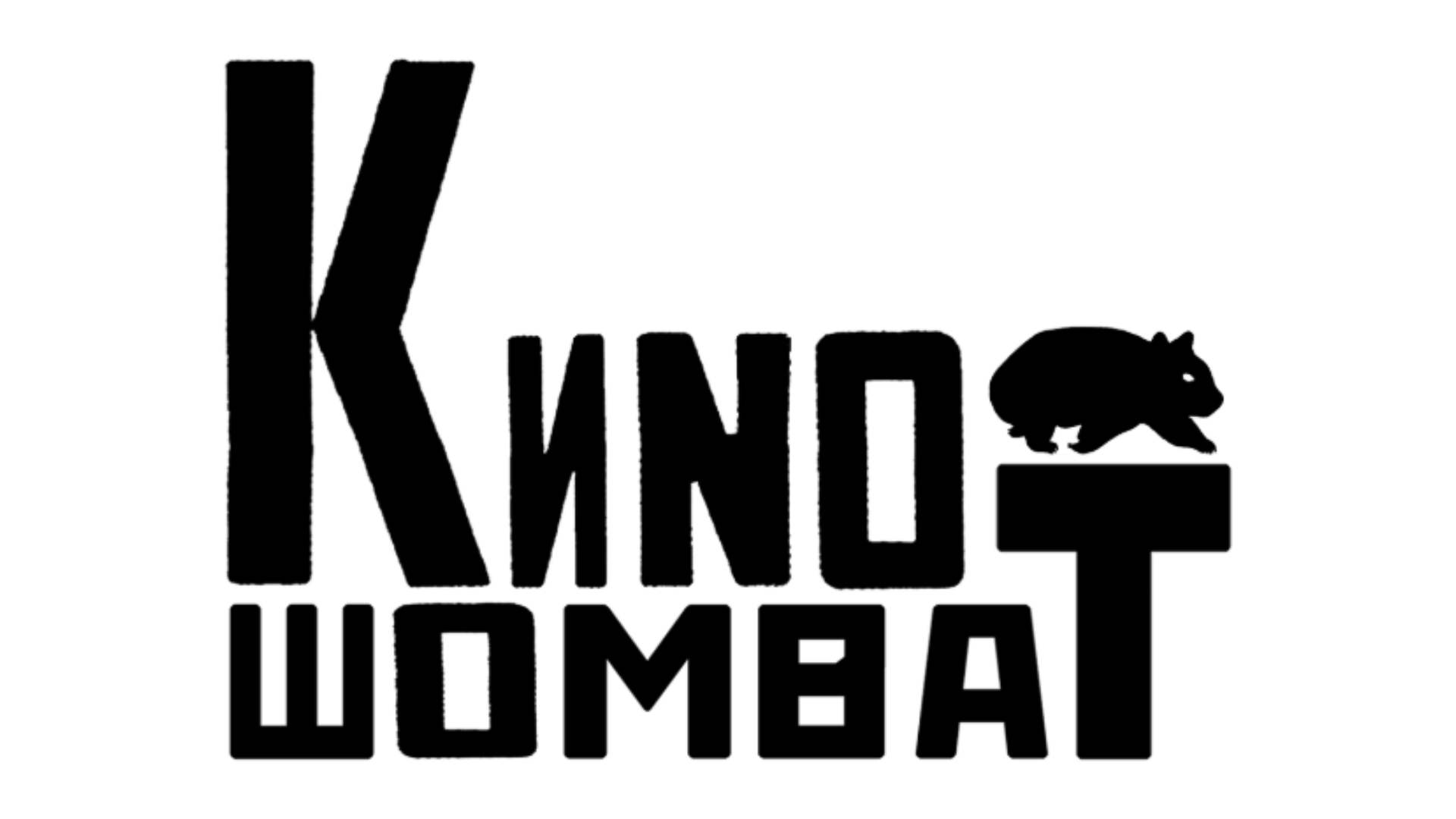

Laisser un commentaire